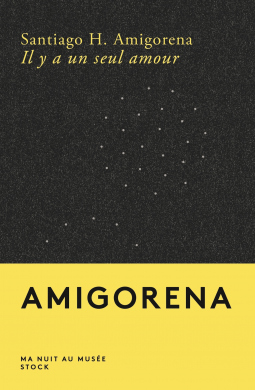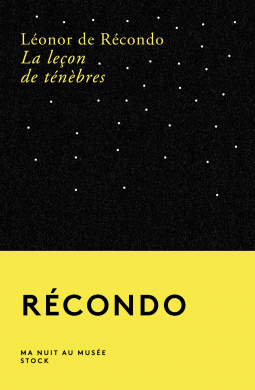Je vous parle aujourd’hui d’un livre qui m’accompagne depuis plusieurs mois déjà et ma chronique a tardé à venir, tant j’avais envie de rester avec Vincent :

Quatrième de couverture :
Une prémonition ? : « Je voudrais faire des portraits qui un siècle plus tard aux gens d’alors apparussent comme des apparitions » En écrivant cette phrase à sa sœur Wil, le 5 juin 1890, Vincent Van Gogh pouvait-il se douter que son souhait se réaliserait ?
Je me suis rendu dans cette petite commune d’Auvers-sur-Oise où la présence de Vincent Van Gogh est toujours perceptible. Je l’ai rencontré. Il est devenu un ami. Je n’ai eu qu’à l’écouter.
Tour à tour joyeux, mélancolique, il m’a raconté, au jour le jour, son activité durant les deux mois qu’il a passés dans cette ville où il était venu pour oublier son mal et se soigner. Intarissable, il m’a fait tout partager : ses joies, ses doutes, ses rencontres, sa tendresse pour son frère Théo. Il m’a décrit ses journées occupées à courir la campagne en quête de motifs et de modèles. Au sommet de son art, il peignait parfois plus d’un tableau par jour. Il m’a expliqué sa technique, sa passion pour cette peinture qui lui faisait dire : « Il y a du bon de travailler pour les gens qui ne savent pas ce que c’est qu’un tableau ».
Ce que j’en pense :
On suit les traces de Vincent durant les trois derniers mois de sa vie : du 17 mai au 27 juillet 1890 pour être précise. Il sort d’une crise éprouvante après vingt-sept mois passés dans la lumière d’Arles et vient passer du temps à Auvers-sur-Oise, rencontre le fameux Dr Gachet, dont Pissaro lui avait parlé et que son frère Théo lui a conseillé de consulter.
Il loge dans la pension des époux Ravoux, couple haut en couleur, et prend ses repas avec un autre artiste, Martinez, qui flirte ouvertement avec la patronne.
Sa première « consultation » avec le docteur Gachet est assez curieuse, de même que ses méthodes thérapeutiques et Vincent va finir par côtoyer cette famille de très près, découvrant les tableaux du médecin, ses estampes, la fameuse presse où il va tester les eaux-fortes, faisant également son portrait et celui de sa fille.
On rencontre aussi Théo et son épouse Jo ainsi que leur bébé, le petit Vincent Willhem, dont il est le parrain, qui sont tous les trois chers au peintre, même s’il a des désillusions parfois, ou se sent coupable d’être entretenu par son frère qui ne roule pas sur l’or.
Vincent va arpenter la campagne pour peindre les blés, les paysans, et le chapitre où l’auteur décrit la manière dont il peint l’église d’Auvers est sublime. On voit le tableau apparaitre sous nos yeux, la manière de manier les brosses. J’ai ressenti une émotion immense, Alain Yvars m’a transmis son amour pour la peinture de Van Gogh, dans cette description, je me suis sentie en osmose. J’aime beaucoup ce peintre torturé et la découverte de ce tableau de la cathédrale a été un choc. Comme tout le monde, j’aime « les tournesols », « Les iris » ou « Nuit étoilée sur le Rhône » entre autres, mais celui-ci m’avait échappé !
C’est Jo qui exprime le mieux ce que représente la peinture de Vincent, lors d’un déjeuner avec le docteur Gachet :
« Je vais vous faire une confidence : dans les « modernes », mon peintre préféré est … Vincent. Ce n’est pas parce qu’il est mon beau-frère, mais sa peinture est celle que je comprends le mieux : franche, directe, expressive. Il peint ce qu’il voit, sans fard, avec un cœur énorme. Je l’admire. »
Le docteur Gachet le complimente aussi : « je perçois chez Vincent la peinture du futur, une sorte de phare pour la peinture moderne » dit-il, et on ne peut qu’être d’accord mais comme on ne peut jamais être sûr de sa sincérité…
On sent la souffrance, la mélancolie de Vincent dans ses attitudes, dans sa peinture et cet ultime voyage nous emmène très loin dans son intimité. Je l’appelle Vincent, comme l’auteur, car nous sommes devenus intimes, il m’a tenu la main, ou j’ai tenu la sienne, je ne sais plus très bien, et surtout car il préférait qu’on l’appelle par son prénom, car on prononçait mal son nom en français.
Vincent ne se contente pas de peindre, il est sa peinture, le pinceau semble être un prolongement de sa main, comme le sont l’archet du violoniste ou celui du violoncelliste par exemple. J’aimerais bien passer une nuit avec lui dans un musée…
Un petit mot du style : l’auteur s’exprime à la première personne, c’est Vincent qui parle, qui raconte ces trois derniers mois, ce qui renforce l’impression d’intimité, de recevoir ses dernières confidences… C’est une très belle idée.
J’ai beaucoup aimé ce livre et il occupe une place particulière dans ma vie durant cette dernière année : Alain Yvars me l’a proposé lors de ma période alitement, sciatalgie, interventions et il ne m’était pas possible de le lire autrement qu’en position debout, pour ne pas l’abimer, car il est très beau, l’auteur a soigné son aspect, en choisissant « Les blés » comme couverture. Il m’a fallu du temps et pour rédiger ma chronique, en fait je l’ai relu pour retranscrire tout mon ressenti.
Je remercie Alain Yvars que les Babeliotes connaissent bien sous le nom de « jvermeer » qui parle si bien de son amour pour la peinture, pour ce cadeau et pour sa patience, ma chronique s’étant fait attendre… son autre livre « Conter la peinture » a lui-aussi été plébiscité par les lecteurs.
Inutile de préciser qu’il s’agit d’un coup de cœur bien-sûr.

Quelques toiles

Extraits
Dans la capitale, je m’étais fait plein de nouveaux amis, les peintres impressionnistes et leur peinture de lumière dont je n’avais pas conscience en Hollande où ma palette restait sombre : Lautrec, Bernard, Pissaro, Anquetin, Koning, Russel, Guillaumin, Gauguin. Nous formions un groupe de pensée et notre religion était la même. Notre art était celui de l’avenir…
Le docteur avait raison, j’allais faire de grandes choses dans ce village. Une étrange connivence s’était déjà installée entre lui et moi… Pourquoi ? Je ne le savais pas vraiment, mais ce lieu me plaisait…
Personne ne m’avait rien demandé sur mon passé. Les idées noires qui me poursuivaient à Saint-Rémy s’étaient évacuées. Une seconde vie commençait.
Mes premières estampes d’aquafortiste n’étaient pas d’un rendu parfait. Je les trouvais incroyablement belles et nouvelles perspectives d’avenir envahissaient mon esprit agité. Je pourrai reproduire mes meilleures toiles avec ce procédé ? Mes motifs du midi… Mon art sera accessible à tous…
Ma palette chargée de pâte s’impatientait. Mes brosses que je saisis savaient déjà ce qu’il fallait faire : emplir de manière colorée les vides laissés par le dessin préparatoire, en variant l’intensité des couleurs. Les taches bleu outremer posées sur les vitraux donnèrent du poids, de l’épaisseur aux murs gris vert. Quelque touches orangées et rouges illuminèrent les toits.
Je peins la vie comme je la ressens. Ma méthode : peindre en une seule fois en se donnant tout entier ; exagérer l’essentiel et laisser dans le vague, exprès, le banal. Un tableau doit être autre chose qu’un reflet de la nature dans un miroir, une copie, une imitation. J’ai compris qu’il ne fallait pas dessiner une main, mais un geste, pas une tête parfaitement exacte mais l’expression profonde qui s’en dégage, comme celle d’un bêcheur reniflant le vent quand il se redresse, fatigué…
Je ne martyrise pas la toile Pacalini, je me bats avec elle ! la peinture est un combat dont le peintre ne sort pas toujours vainqueur…
J’avais besoin de violenter mon nouveau corps qui répondait à mes moindres désirs. Cette fureur sourde de travail allait me guérir. Parfois, le soir, seul, je doutais encore de la persistance de cette forme physique inhabituelle. Depuis deux ans, mes périodes d’accalmie après chaque crise n’excédaient guère trois mois. La dernière avait pris fin vers la mi-avril. Deux mois déjà…
Je peignais pour connaître ces moments-là, ces combats fougueux avec la toile qui voyait le motif inerte me faisant face, s’animer, s’exalter, pour se transformer en quelque chose de nouveau… une œuvre d’art.
Je contemplais le ciel. Depuis mes débuts en peinture, il m’avait procuré mes plus belles émotions. J’aimais toutes ses nuances : plombé, diaphane, laiteux, troublé du Brabant ou de l’île de France. Sans oublier les lumineux, les violents qui m’éblouissaient dans le Midi.